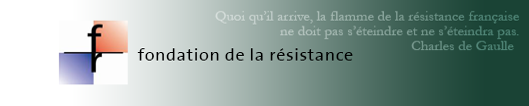
Après libération
- Pédagogie
- Chronologie
- Cartographie
- Bibliographie
- Partenaires
- Crédits
- Introduction
ESPACE PEDAGOGIQUE
Objectif de cet espace : permettre aux enseignants d\'aborder plus aisément, avec leurs élèves, l\'exposition virtuelle sur la Résistance dans la Drôme en accompagnant leurs recherches et en proposant des outils d’analyse et de compréhension des contenus.
L'espace d'exposition s'articule autour d'une arborescence à quatre entrées :
- Zone libre et Occupation,
- Résistance,
- Libération et après-libération,
- Mémoire.
Chaque thème est introduit par un texte contextuel court. A partir de là, des documents de tous types (papier, carte, objet, son, film) sont présentés avec leur notice explicative.
La base média peut être aussi utilisée comme ressource pour les enseignants et leurs élèves dans le cadre de travaux collectifs ou individuels, en classe ou à la maison.
Pour l'exposition sur la Résistance dans la Drôme, sont proposés aux enseignants des parcours pédagogiques (collège et lycée), en lien avec les programmes scolaires, utilisant les ressources de l'exposition :
1/ Collège :
- Note méthodologique
- Parcours pédagogiques composés de :
. Fiche 1 : La France vaincue, occupée et libérée,
. Fiche 2 : Le gouvernement de Vichy, la Révolution nationale et la Collaboration,
. Fiche 3 : Vivre en France durant l'Occupation,
. Fiche 4 : La Résistance.
2/ Lycée :
- Note méthodologique
- Parcours pédagogiques composés de :
. Dossier 1 : L'Etat français (le régime de Vichy),
. Dossier 2 : Les Juifs dans la Drôme (antisémitisme, persécution, arrestation, déportation, protection),
. Dossier 3 : Les résistants,
. Dossier 4 : La Résistance armée,
. Dossier 5 : La Résistance non armée,
. Dossier 6 : La vie quotidienne.
Si vous êtes intéressés par ces dossiers, contactez nous : [email protected]
Réalisation des dossiers pédagogiques : Patrick Dorme (CDDP Drôme), Lionel FERRIERE (enseignant Histoire en collège et correspondant du musée de Romans), Michel MAZET (enseignant en lycée et correspondant des archives départementales).
1. De la déclaration de guerre à l’Armistice, le 22 juin 1940 : Un mois après le début de leur attaque en mai 1940, les Allemands atteignent le nord de la Drôme. L’Armistice arrête les combats sur la rivière Isère. Le nord du département est occupé par les troupes allemandes.
2. De l’Armistice à l’occupation allemande, le 11 novembre 1942 : La Drôme est située en zone non occupée.
3. Du 11 novembre 1942 au 9 septembre 1943 : La Drôme est placée sous administration et occupation italiennes.
4. Du 9 septembre 1943 au 31 août 1944 : l’armée allemande occupe la Drôme ; c’est la période la plus intense pour la lutte contre l’ennemi et le gouvernement de Vichy.
Il s'agit d'une sélection de cartes nationales et locales sur la Résistance. La plupart de ces cartes ont été réalisées par Christophe Clavel et Alain Coustaury. Il s'agit d'une co-édition AERI-AERD tous (droits réservés)
 France de 1940 à 1944
France de 1940 à 1944
 Départements français sous lOccupation
Départements français sous lOccupation
 Régions militaires de la Résistance en 1943
Régions militaires de la Résistance en 1943
 La Drôme, géographie physique
La Drôme, géographie physique
 Esquisse de découpage régional de la Drôme
Esquisse de découpage régional de la Drôme
 Les communes de la Drôme
Les communes de la Drôme
 Carte des transports en 1939
Carte des transports en 1939
 Le confluent de la Drôme et du Rhône
Le confluent de la Drôme et du Rhône
 Densité de la population de la Drôme en 1939
Densité de la population de la Drôme en 1939
 Densité de la population de la Drôme en 1999
Densité de la population de la Drôme en 1999
 Evolution de la densité de population de la Drôme entre 1939-1999
Evolution de la densité de population de la Drôme entre 1939-1999
 Laérodrome de Montélimar-Ancône
Laérodrome de Montélimar-Ancône
 Aérodrome de Valence - Chabeuil - La Trésorerie
Aérodrome de Valence - Chabeuil - La Trésorerie
 Les caches des armes et du matériel militaire
Les caches des armes et du matériel militaire
 Les terrains de parachutages dans la Drôme
Les terrains de parachutages dans la Drôme
 Bombardements alliés et allemands dans la Drôme
Bombardements alliés et allemands dans la Drôme
 Immeubles détruits par les Allemands et la Milice
Immeubles détruits par les Allemands et la Milice
 Emplacement de camps de maquis de 1943 au 5 juin 1944
Emplacement de camps de maquis de 1943 au 5 juin 1944
 Localisation des groupes francs qui ont effectué des sabotages en 1943
Localisation des groupes francs qui ont effectué des sabotages en 1943
 Implantation et actions de la compagnie Pons
Implantation et actions de la compagnie Pons
 FFI morts au combat ou fusillés
FFI morts au combat ou fusillés
 Plan-de-Baix, Anse, 16 avril 1944
Plan-de-Baix, Anse, 16 avril 1944
 Géopolitique de la Résistance drômoise en juin-juillet 1944
Géopolitique de la Résistance drômoise en juin-juillet 1944
 Dispositif des zones Nord, Centre, Sud vers le 10 juin 1944
Dispositif des zones Nord, Centre, Sud vers le 10 juin 1944
 Combovin, 22 juin 1944
Combovin, 22 juin 1944
 Vassieux-en-Vercors 21, 22, 23 juillet 1944
Vassieux-en-Vercors 21, 22, 23 juillet 1944
 Combat de Gigors 27 juillet 1944
Combat de Gigors 27 juillet 1944
 Le sabotage du pont de Livron
Le sabotage du pont de Livron
 Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 21 au 24 août 1944
Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 21 au 24 août 1944
 Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 25 et 26 août 1944
Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 25 et 26 août 1944
 Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 27 au 29 août 1944
Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 27 au 29 août 1944
 Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 29 août à 12 heures le 30 août 1944
Carte simplifiée de la bataille de Montélimar du 29 août à 12 heures le 30 août 1944
 Etrangers au département, non juifs, arrêtés dans la Drôme et déportés
Etrangers au département, non juifs, arrêtés dans la Drôme et déportés
 Déportation, arrestations dans la Drôme
Déportation, arrestations dans la Drôme
 Déportation des Juifs dans la Drôme
Déportation des Juifs dans la Drôme
 Lieu de naissance de Drômois déportés, arrêtés dans la Drôme et à lextérieur du département
Lieu de naissance de Drômois déportés, arrêtés dans la Drôme et à lextérieur du département
 Cartes des principaux lieux de mémoire dans la Drôme
Cartes des principaux lieux de mémoire dans la Drôme
 Perceptions de la Résistance drômoise
Perceptions de la Résistance drômoise
Publications locales :
Une bibliographie plus détaillée sera accessible dans l’espace « Salle de consultation » du Musée virtuel.
SAUGER Alain, La Drôme, les Drômois et leur département. 1790-1990. La Mirandole. 1995.
GIRAUDIER Vincent, MAURAN Hervé, SAUVAGEON Jean, SERRE Robert, Des Indésirables, les camps d’internement et de travail dans l’Ardèche et la Drôme durant la Seconde Guerre mondiale. Peuple Libre et Notre Temps, Valence, 1999.
FÉDÉRATION DES UNITÉS COMBATTANTES DE LA RÉSISTANCE ET DES FFI DE LA DRÔME, Pour l’amour de la France. Drôme-Vercors. 1940-1944. Peuple Libre, Valence, 1989.
DE LASSUS SAINT-GENIÈS (général), DE SAINT-PRIX, Combats pour le Vercors et la Liberté. Peuple Libre, Valence, 1982.
LA PICIRELLA Joseph. Témoignages sur le Vercors, 14e édition, Lyon, 1994
LADET René, Ils ont refusé de subir. La Résistance en Drôme. Auto-édition. Portes-lès-Valence, 1987.
DREYFUS Paul, Vercors, citadelle de Liberté, Arthaud, Grenoble, 1969.
MARTIN Patrick, La Résistance dans le département de la Drôme, Paris IV Sorbonne, 2002.
SERRE Robert, De la Drôme aux camps de la mort, Peuple Libre et Notre Temps, Valence, 2006.
SUCHON Sandrine, Résistance et Liberté. Dieulefit 1940-1944. Éditions A Die. 1994.
VERGNON Gilles, Le Vercors, histoire et mémoire d’un maquis, L’Atelier, Paris, 2002.
Dvd-rom La Résistance dans la Drôme et le Vercors, éditions AERD-AERI, 2007.
Ce travail n’aurait pu avoir lieu sans l’aide financière du Conseil général de la Drôme, du Conseil régional de Rhône-Alpes, du Groupe de Recherches, d’Études et de Publications sur l’Histoire de la Drôme (GRÉPHiD) et de l'AERD qui y a affecté une partie des recettes de la vente des dvd-roms, La Résistance dans la Drôme et le Vercors.
L’équipe de la Drôme tient à les remercier ainsi que :
- l’Office départemental des anciens combattants (ONAC),
- la Direction départementale de l’équipement de la Drôme (DDE),
- le Centre départemental de documentation pédagogique de la Drôme, (CDDP),
- le personnel et la direction des Archives départementales de la Drôme, de l’Isère, des Archives communales de Allan, de Crest, de Die, de Grâne, de Montélimar, de Romans-sur-Isère, de Triors, de Saint-Donat-sur-l’Herbasse, de Saint-Uze,
- les Archives fédérales allemandes (Bundesarchiv), le National Archives and Records Administration (NARA), The National Archives (les archives nationales britanniques), Yad Vashem,
- le Musée de la Résistance en Drôme et de la Déportation de Romans, le Musée de la Résistance de Vassieux-en-Vercors, le Mémorial de La Chau, le Musée de Die, le Musée Saint-Vallier, la Médiathèque de Montélimar, le Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Isère, le Mémorial Shoah, l’Association des Amis du Musée des blindés de Saumur, le Musée de la Division Texas (USA),
- l’Association Études drômoises, l’Association Mémoire d’Allex, l’Association Sauvegarde du Patrimoine romanais-péageois, l’Association Mémoire de la Drôme, l’Association des Amis d’Emmanuel Mounier, l’Association Patrimoine, Mémoire, Histoire du Pays de Dieulefit, l’Amicale maquis Morvan, la Fédération des Unités Combattantes et des FFI de la Drôme, l’Association nationale des Pionniers et Combattants Volontaires du Vercors.
Mais nos remerciements s’adressent surtout à toutes celles et tous ceux, notamment résistantes, résistants et leurs familles, qui ont accepté de livrer leurs témoignages, de nous confier leurs documents et leurs photographies. Ils sont très nombreux et leurs noms figurent dans cette exposition. Ils s’apercevront au fil de la lecture que leur contribution a été essentielle pour l’équipe qui a travaillé à cette réalisation. Grâce à eux, une documentation inédite a pu être exploitée, permettant la mise en valeur de personnes, d’organisations et de faits jusqu’alors méconnus. Grâce à eux nous avons pu avancer dans la connaissance de la Résistance dans la Drôme et plus largement dans celle d’une histoire de la Drôme sous l’Occupation.
L’étude de cette période et des valeurs portées par la Résistance, liberté, solidarité, justice et progrès social…, nous semble plus que jamais d’actualité.
CONCEPTION, RÉALISATION
Maîtres d’ouvrage : Association pour l’Élaboration d’un Cédérom sur la Résistance dans la Drôme (AERD), en lien avec l'Association pour des Études sur la Résistance intérieure (AERI) au niveau national.
Maîtrise d’ouvrage : Carré multimédia.
Gestion de projet AERI : Laurence Thibault (directrice) – Laure Bougon (chef de projet) assistée d’Aurélie Pol et de Fabrice Bourrée.
Groupe de travail : Pierre Balliot, Alain Coustaury, Albert Fié, Jean Sauvageon, Robert Serre, Claude Seyve, Michel Seyve. Patrick Martin et Gilles Vergnon interviennent sur des notices spécifiques.
Sont associés à ce travail tous ceux qui ont participé à la réalisation du Dvd-rom La Résistance dans la Drôme, et qui par la même, ont contribué à une meilleure connaissance de la Résistance dans le département.
Groupe pédagogique : Patrick Dorme (CDDP Drôme), Lionel FERRIERE (enseignant Histoire en collège et correspondant du musée de Romans), Michel MAZET (enseignant en lycée et correspondant des archives départementales).
Cartographie : Christophe Clavel et Alain Coustaury.
Après quatre années de guerre et de gouvernement de Vichy, un bref moment de trouble accompagne la Libération. Ce sont d’abord des jours d’émotion, de liesse pour la grande majorité des Drômois. On fête les résistants, les soldats alliés et de la France libre. Des prises d’armes, des revues sont organisées dans les principales agglomérations, des résistants sont décorés. Les jeunes peuvent organiser des bals publics et exprimer un véritable retour à la vie.
Rapidement après cette brève période d’euphorie, de nombreux problèmes se présentent à tous. S’il faut sanctionner les collaborateurs qui ont contribué à la souffrance des gens, il faut que la justice s’exerce suivant des règles démocratiques. Les fonctionnaires déplacés doivent retrouver leur poste. L’économie doit recréer les conditions de sa reprise. Les transports ne sont pas rétablis magiquement. Les prisonniers et les déportés survivants ne reviendront d’Allemagne qu’à la fin du printemps 1945. Des maquisards se sont engagés dans l’armée jusqu’à la fin de la guerre. L’énergie continue à être contingentée. Les restrictions demeurent parfois jusqu’en 1949 pour certaines denrées. Les municipalités installées par Vichy, sans demander l’avis des habitants, doivent être destituées et remplacées par des conseillers et maires désignés par les mouvements de Résistance, choisis parmi les anciens conseillers évincés ou les résistants, en attendant les élections de 1945. Les Comités de Libération suppléent souvent ces municipalités ou aident celles qui sont restées en place. Il faut reconstruire les ponts, les maisons, les quartiers, les villages détruits par les bombardements ou les combats.
Les journaux collaborateurs – Le Petit Dauphinois et Le Nouvelliste, les quotidiens lus dans la Drôme – sont interdits. Des journaux issus de la Résistance les remplacent comme Les Allobroges, Le Dauphiné Libéré ou Le Travailleur alpin. Des journaux clandestins sont publiés au grand jour, tels Le Résistant de la Drôme, organe du CDL (Comité départemental de Libération) ou Le Patriote romanais et péageois, par exemple, mais leur existence est éphémère.
L’après-libération est aussi une période enthousiasmante. Elle voit la concrétisation des projets contenus dans le programme du Conseil national de la Résistance. C’est, par exemple, la mise en place de la Sécurité sociale en octobre 1945. C’est la possibilité pour les femmes de voter.
Source : François Marcot (sous la direction de), Dictionnaire historique de la Résistance, éditions R. Laffont. Dvd-rom La Résistance dans la Drôme et le Vercors, éditions AERI-AERD, 2007. Claude Alphan

 Voir le bloc-notes (
Voir le bloc-notes (
