Chapitre "La Libération", mémoires de Pinkhes Mints [Aleksander] - [TRADUCTION]
Légende :
Chapitre "La Libération", mémoires de Pinkhes Mints [Aleksander], In di yorn fun yidishn umkum un vidershtand in Frankraykh: perzenlekhe zikhroynes [Dans les années de résistance en France : souvenirs personnels], Buenos Aires, Yidbukh, 1956, pp. 253 à 258.
Traduit du yiddish par Erez Levy (Centre Medem-Arbeter Ring).
Type : Extrait d'ouvrage
Source :
Analyse média
La Libération
(Mémoires d’Aleksander Mints, pp. 253 à 258)
Avec plus d’un million d’habitants, Lyon est l’une des plus grandes villes françaises, singularisée par la confluence de deux fleuves qu’enjambent de nombreux ponts et passerelles.
Comme il est d’usage durant les guerres, les Allemands détruisirent les ponts lyonnais dans leur retraite.
Au cours de ces semaines où les bombardements avaient déferlé sur la ville, nous avions perdu la mémoire de cette loi stratégique, mais nous ne fûmes pas surpris lorsque nous entendîmes, à la dernière nuit de cette retraite, des explosions et des déflagrations. Nous n’imaginions cependant pas qu’ils puissent être le fait des Allemands, ni celui des Résistants. Le ciel nocturne se trouva alors envahi sans discontinuer par les lueurs des incendies qui suivaient ces explosions. Ni ma femme ni moi ne pûmes évidemment fermer l’œil un seul instant cette nuit-là et nous demeurâmes jusqu’à l’aube tenaillés cette interrogation insondable : que se passait-il exactement ?
Dès le matin, la gardienne vint nous trouver pour nous annoncer la grande nouvelle : « Les Américains arrivent ![1] »
« Les unités armées des forces de résistance ont fait leur apparition aux abords de Lyon et marchent vers la ville. Toute la nuit, les Allemands ont fait sauter un à un les ponts de la ville[2], mais à présent les Boches sont partis ! »
Nous courons au dehors et en effet, malgré l’heure très matinale, une grande animation règne sur toute la ville. Les gens semblent transformés ; à chaque coin de rue, des groupes se forment, ainsi qu’aux entrées des immeubles et des cafés, on parle à voix haute : « les Américains approchent ! On les a vus ! Les nôtres, venus des maquis[3], sont en marche, armes à la main ; eux aussi, on les a vus ! » Dans les rues, la foule se fait plus dense et animée à mesure que l’on s’approche du centre de la ville.
Nos yeux voient apparaître les premiers rayons de la liberté ! Voici que s’approchent les premières unités blindées américaines, et c’est un tonnerre d’applaudissements, dans un enthousiasme indescriptible, qui accueille ces premières colonnes de l’armée régulière. Les visages des « boys » américains, perchés sur leurs pièces d’artillerie automotrices, ou marchant à leurs côtés, resplendissent, tandis que la foule les couvre de fleurs, ces décorations que les Françaises ne manquèrent pas de leur offrir. Derrière les « boys », ce sont les Résistants français qui défilent, d’un pas solide, eux aussi accueillis par des exclamations de ferveur. Les Françaises et les Français, larmes aux yeux, se jettent dans leurs bras. Tout n’est qu’éclats de joie, tandis que les chants retentissent dans une pluie de fleurs. Toute circulation est immobilisée dans le déluge humain qui submerge la ville, où tous se fondent en une seule masse, dont nous aussi faisons partie, le petit nombre des Juifs survivants restés à Lyon.
Qui serait capable de représenter les émotions qui triomphent dans un tel moment, où tous les sens humains perçoivent d’un seul coup la liberté retrouvée ? Seuls ceux qui vivent un pareil instant peuvent en mesurer l’immensité, et seuls ceux qui ont un jour perdu la liberté peuvent véritablement éprouver la joie de la retrouver.
Il m’était personnellement déjà arrivé plusieurs fois de vivre de semblables moments, lorsque je fus libéré de prison, en voyant devant moi s’ouvrir les lourdes portes de fer de ma cellule, en m’entendant déclarer la fin de ma détention. J’avais plusieurs fois goûté à cette même sensation, d’une douceur inouïe, comme celle qui m’assaillit lorsque je vis tourner le petit portillon du grand porche d’acier de la prison et entendis le factionnaire me dire : « Vous pouvez partir ». Les premiers pas posés sur le pavé du libre extérieur furent certes vacillants, et le vertige ne manqua pas de me faire chanceler lorsque je humai avec un délice inexprimable les premiers souffles du grand air. Ma tête tournait comme si j’avais bu une puissante liqueur, tandis que mes jambes tremblaient à tout rompre. C’est par de telles sensations que s’exprima en moi l’ivresse de la liberté retrouvée.
C’était la même sensation d’ivresse qui s’empara de moi ce jour-là dans les rues lyonnaises. Nous sommes libres ! Est-ce bien vrai ? Oui, c’était vrai, puisque nous rencontrions[4] en pleine rue d’autres amis et que chacun arborait le même visage heureux. Nous sommes libres !
Nous entrons dans un café, mais qui peut se frayer un chemin jusqu’au zinc ?! Quelle cohue ! Quelle joie ! Français et Françaises, gens du peuple et de toutes les autres couches de la population lèvent leurs verres, submergés de l’immense émotion de savoir que la France redevenait libre, que chaque jour ses villes, l’une après l’autre, recouvraient la liberté. Ici et là apparaissent des groupes d’Allemands qui n’avaient pas réussi à suivre la retraite de leurs troupes et marchent à présent sous bonne garde en convois de prisonniers. Ce sont eux qui sont accablés à présent. Personne ne veut quitter la rue, personne ne ressent la faim, tous ont oublié les besoins et les devoirs du quotidien. Chacun s’extasie devant le moindre détail et chaque visage déborde de bonté, d’amitié et de solidarité humaine. C’est une masse en liesse qui a rompu les chaînes de son esclavage et se trouve à nouveau libre.
En ce même moment disparaissent les éternels contrastes et distances entre jeunes et vieux, entre hommes et femmes. Tous forment à présent une seule masse enivrée. Il n’y a pas l’ombre d’un policier dans les rues et pourtant aucun méfait n’est à signaler dans la ville. Tous sont emportés par un seul sentiment humain et patriotique : nous sommes libres ! Notre ville est libre !
En l’espace d’un instant, l’ennemi sanguinaire avait disparu avec ses supplétifs vichystes. Disparu, le pouvoir étranger et barbare qui avait bafoué dans un tel déchaînement de violence jusqu’aux plus élémentaires des sentiments humains et nationaux en épuisant quotidiennement, de longues années durant, les ressources vitales du pays.
Et si j’avais certes déjà éprouvé dans ma vie le bonheur d’être délivré de mes chaînes, ce moment-là fut celui d’une émotion sans égale, car dans les prisons polonaises, ce n’avait pas été la menace d’une inévitable mise à mort, dans les conditions les plus atroces, qui avait pesé sur moi, comme ce fut le cas dans les camps allemands. Rares avaient été, en effet, les détenus politiques polonais qui avaient dû purger la totalité de leur peine ; beaucoup d’entre eux furent libérés avant le terme fixé par leur jugement, que ce soit par suite d’une amnistie générale ou pour d’autre raisons. Mais tomber sous les griffes de l’atroce Gestapo signifiait la mort assurée, pour chacun ou presque[5]. Parmi les cent vingt mille Juifs déportés de France, deux mille d’entre eux à peine revinrent des camps.
Assister à la débâcle d’Hitler, quelle plus grande consolation pouvait advenir pour tous ceux qui, de longues années, avaient mené un combat désespéré contre la bête allemande ?
Je suis désormais libre et la liasse de faux papiers que je portais toujours sur moi me fait à présent l’effet d’une charge sans objet. Avec quelle reconnaissance pourtant je contemplais mes faux papiers ! D’année en année, ils m’avaient donné l’illusion de suffire pour me sauver. Dès aujourd’hui, ils appartenaient donc au passé. J’allais les cacher quelque part, comme des reliques du temps de la Destruction, bien qu’ils soient désormais privés d’autre signification.
Telle fut donc l’ivresse que nous partageâmes ce jour-là avec le peuple lyonnais. Dans les rues passaient les jeunes gens armés appartenant aux organisations patriotiques de combat, qui me rappelaient d’une certaine façon les jours de 1918 où les Allemands avaient quitté la Pologne, laissant place aux patrouilles armées des jeunes patriotes polonais dans les rues de Łódź.
Ainsi se passèrent les premiers jours de la Libération. Après chaque grande vague d’émotion venait l’apaisement et le dégrisement, comme la vie quotidienne revenait après une journée de célébration religieuse.
Nous, survivants miraculés parmi les membres de la direction de notre parti, nous retrouvâmes et commençâmes à analyser ensemble la situation nouvelle à et définir nos missions les plus immédiates en tant qu’organisation. Mais alors que nous tentions d’établir les bribes d’un bilan au regard de notre condition juive et de l’état de notre mouvement, un douloureux chagrin nous accabla, que chaque jour rendait plus implacable à mesure que l’étendue inconcevable de la destruction des Juifs se précisait, révélant à nos yeux la plus effroyable tragédie de toute l’histoire du peuple juif. Lorsque nous apprîmes le sort atroce réservé à nos proches, à ceux qui nous étaient les plus chers, chacun d’entre nous se trouva en proie à une peine et une douleur sans égales. De toutes parts commençaient à nous parvenir ces mots lugubres : « La communauté juive de cette ville n’existe plus ; personne n’y a survécu[6]… » Tout autour de nous, depuis les moindres recoins de notre pays natal, nous nous sentions placés sous le regard de têtes de morts qui nous scrutaient à travers leurs cavités oculaires dénudées.
Notre joie sans mélange des jours où la Libération avançait à pas conquérants et de ceux où elle était fêtée partout n’aura pas duré longtemps.
L’image macabre du peuple juif mené au sacrifice se mit à nous hanter sans répit, et la joie renaissante tout comme le désir revigoré de bâtir une vie nouvelle succombaient devant elle, comme si elle déversait sans cesse les gouttes d’un poison inexorable sur nos esprits. Dans les coupes qui avaient étanché nos âmes du nectar de cette joie nouvelle, c’était une dose intarissable de tristesse et de larmes que nous buvions depuis que parvenaient les nouvelles du crime de masse hitlérien qui avait frappé des millions de Juifs.
Lorsque se tient le premier rassemblement de notre parti dans la France libérée, les camarades présents se jetèrent tous dans les bras les uns des autres en versant des larmes de joie avant de se figer dans le chagrin, la douleur et le deuil. Nous commençâmes à rappeler un à un les noms de nos camarades et amis qui avaient péri, en héros et martyrs de la liberté et de l’existence juive, dont les spectres en s’amoncelant formaient à présent une immense montagne à laquelle nos regards étaient rivés.
C’est ce mélange de joie et de douleur qui imprégnait nos âmes lors des rassemblements et des réunions amicales que notre organisation bundiste tenait alors. Sous l’occupation hitlérienne, quoi que nous fassions, nous étions toujours heureux de réaliser une action de secours pour la communauté juive en général ou plus spécialement dans l’esprit socialiste et bundiste. Nous avions après tout échappé jusqu’alors aux périls mortels et au sort tragique de tant de nos camarades et amis qui avaient péri en déportation. Mais à tout moment nous nous posions la question de savoir s’il était possible de s’estimer heureux en sachant l’ampleur effroyable de la tragédie juive ?
Nous étions véritablement la génération la plus malheureuse de toute la longue histoire du peuple juif. Peut-on imaginer pire malédiction que celle de se trouver le seul survivant de sa famille proche ou éloignée ? Peut-on connaître une plus cruelle tragédie que celle de survivre à la disparition de la judaïcité est-européenne ?
J’avais le sentiment que nous étions les derniers représentants d’un peuple destiné à disparaître, qu’avec nous s’achèverait l’histoire du merveilleux[7] peuple juif, car pour nous le peuple juif s’identifiait à la judaïcité de l’Europe orientale. C’était l’histoire de notre peuple qui touchait à son terme en même temps que mon existence personnelle ; quel sens pouvait-il y avoir à vivre après la Destruction ?
Et c’est véritablement un miracle qui se produisit alors : une force vitale se fit jour au fond de chacun de mes camarades, comme un élan et un désir de vivre, de bâtir une nouvelle vie.
« Continuité », « existence » devinrent les mots nouveaux qui scandèrent nos rassemblements et nos conversations privées. Bâtir, élever de nouvelles générations, ces idéaux animaient le désir de vivre, l’élan vital qui se mit à nous gagner tous.
Et c’est avec une énergie renouvelée et une foi affermie dans l’avenir juif, profondément inspirées par la vaste vision d’un monde nouveau fait de justice morale et sociale que nous reprîmes notre action pour la reconstruction de la vie juive.
[1] L’entrée dans Lyon du groupe Vigier, composé d’éléments de la 36ème division d’infanterie américaine et de la 1ère division française libre eut lieu le 3 septembre 1944, alors que la plupart des troupes allemandes avaient quitté la ville et que d’autres éléments militaires américains et résistants y étaient entrés depuis l’avant-veille.
[2] Le pont de l’Homme-de-la-Roche et la passerelle Saint-Vincent furent sauvés par le colonel J. Laval.
[3] P. 254.
[4] P. 255.
[5] P. 256
[6] P. 257.
[7] P. 258.

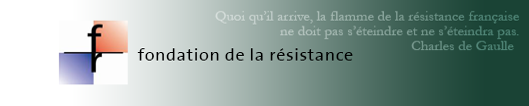
 Voir le bloc-notes
()
Voir le bloc-notes
()