La Résistance
(1) Lors des premiers mois du régime de Vichy, la Résistance est surtout le fait d'individualités refusant l'armistice et les prétentions italiennes , voire les orientations de l'Etat français ; leur action se limite le plus souvent à des discussions, des échanges de lettres, des papillons manuscrits, l'écoute de Radio-Londres, même si certaines actions collectives d'ampleur sont observées, tel le sabotage d'une vedette italienne au chantier naval d'Antibes, le 12 août 1940.
A Cannes, le général Cochet entame une tournée de propagande orale en zone "libre" et rédige, le 6 septembre, son premier appel "Veiller, résister, s'unir", qui va commencer à fédérer de petits groupes.
Fin 1940, le réseau polonais F2 installe à Nice le PC de son sous-réseau Marine, qui couvre le littoral de Sète à Menton.
Le 30 novembre, René Cassin s'adresse sur Radio-Londres à ses compatriotes des Alpes-Maritimes, exaltant le combat de la France libre, dénonçant la disparition des libertés et les prétentions italiennes.
En décembre, Emmanuel d'Astier de la Vigerie et le commandant Corniglion-Molinier fondent à Cannes "La Dernière colonne", destinée à saboter les trains, mais l'aviateur azuréen est arrêté peu après.
L'ingénieur Claude Bourdet, replié à Vence, entre d'abord en contact à Cagnes-sur-mer avec l'écrivain royaliste Georges Batault - en désaccord avec l'Action française et dont le fils est gaulliste - et rencontre chez lui le capitaine polonais "Vincent" Jordan-Rozwadowski, adjoint du général Kleeberg, qui lui demande de fournir à son réseau des renseignements économiques.
Début 1941, Jean Moulin s'installe à Nice sous son vrai nom et y entreprend son passage dans la clandestinité, obtenant en février, grâce à F. Manhès, un passeport au nom de "Joseph Mercier", délivré à Grasse.
Du côté des communistes, Pierre Georges (futur "colonel Fabien") arrive à Nice à la fin octobre 1940, porteur de tracts "L'appel au peuple de France", publiés par extraits dans l'organe des Jeunesses communistes réconstituées, Jeunesse.
(2) L'organisation de la plupart des mouvements et réseaux s'effectue en 1941-1942 mais la structuration définitive intervient en 1943, avec la naissance des Mouvements Unis de Résistance (MUR), du MNRPGD et de l'ORA. Sous la houlette de Jean Moulin et de Maurice Chevance "Bertin", les mouvements Combat, Franc-Tireur et Libération-Sud fusionnent leur groupes francs en octobre 1942, diffusent des tracts communs en novembre, et, à partir de janvier 1943, négocient la fusion au sein des MUR, dirigés par Raymond Comboul puis par Raoul Attali, tous deux issus de Combat mais la plupart des cadres sont fournis par Libération-Sud.
L'Organisation de Résistance de l'Armée (ORA) regroupe des cadres de l'armée d'armistice, démobilisés après le 11 novembre 1942 et hostiles à l'Allemagne. Elle est mise en place, en juillet 1943, par le colonel Journois et le commandant Pourchier. En 1944, elle est dirigée par le commandant Ceccaldi ("Bob), puis par le lieutenant Gauthier ("Malherbe"), en étroites relations avec le chef régional Lécuyer ("Sapin") ; au printemps, elle absorbe le groupe Rémy (qui a perdu le contact avec les MUR) et le groupe Surcouf.
Jean-Louis Panicacci, (2) La Résistance azuréenne, Serre, 2003 (p. 26).
Jean-Louis Panicacci, (1) Les Alpes-Maritimes de 1939 à 1945, un département dans la tourmente, Serre, 2003.
L'aide et le sauvetage ou la Résistance humanitaire haut ▲
Des organisations et des groupes, français ou étrangers, aident les réfugiés, nombreux dans la région, certains internés au camp des Milles. Ils tentent, par des moyens légaux ou non, de sauver ceux qui sont en danger en les cachant ou en les faisant sortir de France. C'est le cas, par exemple, de Gilberto Bosques et de son équipe du consulat du Mexique à Marseille pour les républicains espagnols, de Varian Fry et du Centre américain de secours (CAS) pour les intellectuels et artistes, du réseau Marcel à Nice pour les enfants juifs.
Brochure du MUREL, p. 4
La propagande haut ▲
Les mouvements de Résistance se forment et se développent très tôt dans la région. Ils consacrent une grande part de leur activité à la confection et à la diffusion de journaux clandestins. Ces derniers font contrepoids à la propagande de Vichy et des occupants, fournissent des informations censurées dans la presse légale et à la radio et appellent à la lutte pour la libération du pays.
En plus de la presse clandestine, la Résistance s'exprime par des moyens très variés : inscriptions, papillons, tracts. On en trouve ici deux exemples au travers de deux tracts du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France, l'un à Nice, contre les mesures anti-juives, l'autre à Pertuis, contre l'envoi de la main-d'oeuvre en Allemagne. La Résistance détourne aussi les affiches de Vichy et émet de faux timbres-poste à l'effigie du général de Gaulle.
Brochure du MUREL p. 6
Les manifestations patriotiques organisées haut ▲
- manifestations patriotiques (défilés les jours anniversaires de grandes dates de la République : 11 novembre, 14 juillet)
- manifestations de ménagères (en appeler aux femmes pour s'élever, entre autres, contre les restrictions et le marché noir)
Des manifestations patriotiques ont lieu à plusieurs reprises, à l'appel de Radio-Londres et des mouvements locaux, à l'occasion du 14 juillet, les appels relatifs aux 1er mai et 11 novembre rencontrant peu d'écho. Le 14 juillet 1942 est surtout marqué par un pavoisement et un rassemblement de quelques centaines de jeunes scandant "Vive de Gaulle" et "Mort à Laval et à Hitler", qui dégénère en pugilat avec des contre-manifestants SOL et PPF, la police étant vite débordée.
Les faux papiers et le NAP haut ▲
Le Noyautage des Administrations Publiques (NAP) est rendu possible par l'adhésion à la résistance de plusieurs cadres publics, tels que l'Inspecteur départemental du Travail, Pierre Gatet, et le chef de division, Hector Cendo à la préfecture, l'ingénieur Jacques Romanetti à la SNCF, l'intendant Raoul Brès au Ravitaillement, le secrétaire général François Sattegna et les chefs de bureau Jules Bascans et Emile Lauck à la Mairie de Nice, voire par la connivence de l'intendant de police Paul Duraffour, jusqu'à son départ forcé en avril 1944. (1)
(2) Parallèlement, pour protéger les clandestins (réfractaires au STO, Juifs...) et prendre en charge le ravitaillement, les résistants doivent jouer les faussaires (faux papiers d'identité, faux certificats d'embauche ou de baptême, fausses cartes d'alimentation, faux tampons, etc.). Le groupe "14 Juillet" s'y adonne prioritairement. (p. 30)
(1) Jean-Louis Panicacci, "l'Action de la Résistance", in La Résistance azuréenne, Serre, 2003. (p 28) et p.30 pr 2)
Les réseaux de renseignement et d'évasion haut ▲
[Les réseaux de renseignements transmettent aux Alliés et à la France libre des informations sur le système défensif et les mouvements de troupes des occupants. Celles-ci sont utilisées, en particulier, pour préparer le débarquement.]
Réseau OLIVE (Buckmaster), Marcel BASI
Le réseau Pat O'Leary, la plus importante filière d'évasion d'aviateurs et de militaires alliés de la Résistance, s'intéresse aux aviateurs anglo-saxons détenus au fort de la Revère, à proximité de la Turbie.
En mai 1943 se produit à Nice, boulevard Joseph Garnier, la rocambolesque évasion à moto de Jacques Robert, fondateur du réseau Phratrie, aidé par les commissaires Dubois et Peretti (réseau Ajax). (1)
(1) La Résistance azuréenne, Serre, 2003.
Les sabotages haut ▲
L'arrivée d'explosifs par la voie maritime, puis aérienne, débouche sur de nombreux sabotages d'usines (3 sous Vichy, 7 sous l'occupation italienne, 34 sous l'occupation allemande), de voies ferrées, de lignes téléphoniques, de pylônes électriques (6 sous Vichy, 23 sous l'occupation transalpine, 65 sous l'occupation allemande), de matériel ennemi (21 visant la IVa Armata, 40 la Wehrmacht et la Kriegsmarine). Les sabotages les plus significatifs concernent : la voie ferrée PLM entre Cannes et Monaco (une trentaine de coupures d'octobre 1942 à juillet 1944) l'explosion des dépôts de munitions de Menton (1er novembre 1943) et de Cannes-St-Cassien (10 février 1944), etc.
Le sabotage de l'usine des Aciéries du Nord de Cannes-La Bocca (réparation de matériel ferroviaire) est demandé par Alger, début mai 1944. La première tentative du 2e détachement FTP et du groupe AS de l'usine échoue le 15 mai, mais la seconde, dans la nuit du 5 au 6 juin, réussit pleinement, interrompant la production pendant 15 jours. Le sabotage est une activité quotidienne pour certains cheminots du dépôt SNCF de Nice-St-Roch.
La Résistance azuréenne, Editions Serre, 2003.
Les attentats haut ▲
Entre avril 1941 et août 1944, collaborateurs et occupants sont visés par 264 attentats : 27 sous Vichy, 75 sous l'occupation italienne, 16 sous l'occupation allemande. Au début, les attentats prennent la forme de plasticages de permanences politiques (Légion, PPF? LVF...) et de commerces.
Avec l'occupation transalpine, on assiste à une radicalisation de la lutte et le sang coule pour la première fois : 11 permanences politiques, l'Office de placement allemand (OPA) et 22 commerces appartenant à des partisans "de l'ordre nouveau" sont plastiqués, tandis que 11 agressions de collaborateurs et 24 d'occupants font 11 tués et 14 blessés. Les attentats les plus meurtriers ont lieu à Nice : un officier italien tué et deux autres blessés le 27 avril 1943 ; un soldat transalpin tué et trois autres blessés le 8 juillet ; un soldat de la IVa Armata tué et quatre ressortissants italiens blessés le 20 juillet ; deux soldats allemands tués et neuf autres blessés le 25 décembre dans l'explosion d'une bombe au café "Noailles" ; cinq soldats de la Wehrmacht tués et quatre blessés dans l'explosion d'une bombe au cinéma "Malausséna" le 16 janvier 1944 ; deux employés de la Reichsbahn (chemins de fer allemands) abattus le 28 juin.
Plusieurs collaborateurs notables sont abattus par des résistants : le docteur Adolphe Tourtou (adjoint au maire de Nice et secrétaire fédéral du PPF) à Nice le 24 novembre 1943 ; Ernest Dausse (chef du 4e service de la Milice) à Nice le 6 février 1944 ; le docteur Charles Passeron (maire et président de la LFC de Lantosque, cadre du PPF) à Lantosque le 24 juillet ; l'avocat Georges Bensa (auteur des discours de Darnand, cadre de la LFC et du PPF) à Nice le 2 août. L'attentat le plus spectaculaire a lieu à Nice le 28 novembre 1943 : une grenade lancée contre les Miliciens de l'escorte de Darnand, sortant du restaurant légionnaire, fait 5 morts et 6 blessés.
Au total, 142 actions de résistance sont recensées dans le département sous Vichy, 224 (dont 130 armées) sous l'occupation italienne, 344 (dont 274 armées) sous l'occupation allemande, ce qui est inférieur à l'activité des résistants varois : 347, 435 et 692.
La Résistance azuréenne, Editions Serre, 2003.
Les cols et détournements haut ▲
Les opérations maritimes haut ▲
Les agents du SOE, en liaison avec l'organisation Carte comme avec le docteur Lévy - chez lequel logent habituellement les arrivants et les candidats au départ - organisent en 1942 une douzaine de débarquements ou d'embarquements sur le littoral azuréen, entre Théoule et Cros de Cagnes, la plupart ayant lieu à Antibes. Ils sont effectués par des sous-marins et des felouques approchant le rivage au cours de la nuit.
L'opération maritime la plus célèbre a lieu le 17 avril 1942 à Antibes où deux agents débarquent avec des émetteurs tandis qu'embarque Emmanuel d'Astier de la Vigerie, qui se présentera à Londres comme l'émissaire de la Résistance intérieure.
Les opérations maritimes cessent avec l'occupation italienne, compte tenu de la densité des troupes déployées le long du littoral, mais se poursuivent sur d'autres portions de la côte.
L'organisation Carte reçoit par la voie maritime jusqu'au 31 août 1942, 70 radios et deux tonnes de matériel, immergées à Antibes dans des conteneurs spéciaux ou stockées à La Bocca.
Existent également les opérations maritimes destinées à torpiller l'effort de guerre ennemi. Ainsi, le 6 avril 1943, l'Armée secrète (AS) d'Antibes apprend que le vapeur Penmarch va quitter Nice pour Toulon avec un chargement destiné à la Kriegsmarine. Le commandant Vallet lance un message radio et un sous-marin coule le cargo une semaine plus tard. De même à la suite du dramatique bombardement de La Bocca, qui a fait 42 morts et 2 200 sinistrés sans interrompre plus d'un mois l'usine SNCASO, la Résistance cannoise lance un message radio et l'établissement est bombardé, à un mille nautique, par un sous-marin, le 23 janvier 1944, qui détruit un atelier et endommage sérieusement six prototypes d'avions sans faire de victime.
La Résistance azuréenne, Editions Serre, 2003.
Les opérations aériennes haut ▲
L'essentiel des opérations aériennes est constitué par des parachutages effectués dans l'arrière-pays pour le compte du SOE, de l'ORA ou de la SAP.
Une quinzaine de parachutages sont effectués de l'été 1943 à l'été 1944 avec des cargaisons inégales. Le 14 mars 1944, 66 tonnes sont parachutées sur le plateau de Dina, puis, à "Camp Lucéram" quinze jours plus tard.
Les colis contiennent généralement des armes, des munitions et des explosifs et parfois des produits pharmaceutiques, de la nourriture et du tabac, de l'argent, des postes émetteurs et, vers la fin de l'occupation, des brassards FFI.
Des armes parachutées dans l'Est varois et le sud des Basses-Alpes pour le compte de la SAP ou du SOE parviennent dans les Alpes-Maritimes par des transports périlleux.
La répartition des armes est une pomme de discorde entre les mouvements, les FTP se plaignant d'être tenus à l'écart et devant procéder à quelques récupérations (Carros) ou partages forcés pour équiper sommairement leurs unités. Le commandement FTPF adresse une vive protestation à Alger, le 10 avril 1944, à propos des stocks d'armes immobilisés, trop facilement repérés par l'ennemi.
L'Armée secrète se plaint, également, de l'action de la SAP tandis que le mouvement Combat bénéficie de quelques armes reçues par le SOE, en échange de l'aide qu'il lui a fournie lors de parachutages.
La Résistance azuréenne, Editions Serre, Nice, 2003.
Les maquis haut ▲
A partir de février-mars 1943, Armée secrète (AS) et Francs-Tireurs et Partisans (FTP) implantent leurs premiers maquis. Les maquis AS du Ventoux forment l'un des ensembles maquisards les plus stables et puissants. Le maquis FTP des Maures donnera naissance à la 1ère compagnie de Provence, sorte d'unité mère pour les FTP de toute la région. Contrainte de quitter le Var, elle rejoint les Basses-Alpes, devenues en 1944 le principal lieu de concentration maquisarde en R2.
Le MNRPGD, absorbé en mars 1944 par l'ORA, mit en place un maquis, commandé par un officier de marine, Foata-Morgan, l'un des rares maquis maralpins à avoir connu une existence régulière et ordonnée.
Dès mars 1944, de nouveaux maquis sont signalés dans la région de Bar-sur-Loup, d'Aiglun, d'Auribeau; de St-Cézaire, de Roussillon. Ces maquis sont des groupes peu nombreux (celui de Roussillon compte une dizaine de membres), mais partiellement armés et prêts pour des coups de main. Le maquis d'Auribeau compte une majorité d'Italiens. D'autres maquis se sont formés dans la région transalpine de la Haute-Vésubie, appelés à jouer un rôle important lors de l'offensive allemande du 18 août 1944.
La mise en place d'un état-major FFI, en mars 1944, va changer la donne. Le chef départemental maquis, le capitaine "Rodolphe" va s'appliquer à constituer un maquis exclusivement ORA dans la région de Beuil et dans la région de Vence.
Les FTP essaimeront leurs effectifs dans les maquis de Carros, Gattières, Malaussène, Le Brec d'Utelle, Levens. Les MOI monteront un maquis à Peille, Combat en organisera un à Aspremont (sous la houlette du commandant Gérome). Entre avril et mai, d'autres groupes seront signalés à Amirat, Tourrettes-sur-Loup, St-Jeannet, St-Auban. On estime que les FTP sont environ 80 à la fin de mai 1944, pour un total approximatif de 250 FFI.
Le problème de l'armement est aussi crucial que celui du ravitaillement. Faute d'armes provenant de parachutages, les FFI maralpines ont dû récupérer des armes de départements voisins, en particulier à Fayence dans le Var.
Ce qui caractérise donc ces maquis en ces mois précédant le débarquement de Normandie, ce sont : le caractère de mobilité, à la fois pour des raisons de sécurité et de subsistance ; l'insuffisance de leur encadrement comme de leur armement ; leur manque de cohésion par le fait que l'autorité du chef départemental FFI s'exerce mal ou n'est pas reconnue. Ces maquis ne cherchent pas l'accrochage avec les Allemands : avant juin 1944, il n'y a eu que trois accrochages (le 19 avril 1944 au château du Castelet de St-Jeannet, le 3 mai à Puget-Théniers et le 23 mai à Saorge).
La Résistance azuréenne, Editions Serre, 2003.
Les territoires libérés haut ▲
Mobilisation du 6 juin 1944 et combats prélibérateurs haut ▲
(insurrection du Haut-Var)
Le 7 juillet 1944, le capitaine François fait sauter le pont du Pra d'Astier, dans les Gorges du Cians, et le lendemain le viaduc de Berthéou, dans les gorges de Daluis. Le 9 juillet, Beuil, Péone-Valberg, Guillaumes et St-Martin-d'Entraunes passent sous le contrôle des FFI, un comité de libération est constitué, le drapeau tricolore arborant la Croix de Lorraine flotte sur le quadrilatère du Haut-Var, tenu par 150 hommes disposant de 3 mitraillettes légères, 4 fusils mitrailleurs et d'une arme individuelle par combattant.
(La tâche principale du premier CLL de Beuil est d'assurer le ravitaillement.) L'hôtel Edelweiss devient le quartier-général de la zone insurgée. Des suspects sont arrêtés et 3 exécutions ont lieu avant le débarquement de Provence : le 12 juillet à Beuil, le 4 août à Daluis et le 14 août à Péone.
Le 18 juillet, 700 Allemands se concentrent à Touet-sur-Var et Entrevaux, puis s'engagent dans le fond des Gorges du Cians et de Daluis, échouant devant les tirs d'armes automatiques des postes du Pra d'Astier et du Berthéou tenus par les FFI.
Le Pra d'Astier est évacué le lendemain et, le 20 juillet, les Allemands attaquant par les crêtes prennent le col de Roua. Les FFI se replient alors sur Villeplane, disséminant des grenades piégées dans le tunnel. Guillaumes est évacuée le lendemain à 19 heures et les Allemands y pénètrent le 21 juillet à 7 heures, recevant le renfort de 150 hommes descendus du col des champs ; Beuil est alors évacuée à midi, la plupart de ses habitants allant se réfugier dans les chalets d'alpage, tandis que les FFI gagnent la Baumette. Pourtant, les soldats de la Wehrmacht ne procèdent pas à un ratissage en règle, puisqu'ils ne montent même pas à Valberg et décident d'évacuer Guillaumes le 24 juillet, après avoir déploré 95 blessés. Dès le lendemain, les FFI dispersés dans le massif du Mounier reprennent position dans le quadrilatère du Haut-Var. Ils essaiment le 4 août vers la Tinée, créant 2 maquis à Ilonse (André) et Bairols (Pierre) recrutant sur place une centaine d'hommes disposant d'un armement modeste. Ils reçoivent le 6 août à Valberg le renfort de 25 marins-pompiers de Marseille commandés par le capitaine Imbert, puis le 8 août, de Sapin et d'une bonne partie des hommes ayant opéré sous ses ordres dans les Basses-Alpes, précédant de quelques heures la mission alliée ne comprenant encore que le major écossais Bambous et le capitaine Fournier ("Calice").
Des parachutages ont lieu sur le plateau St-Jean-Baptiste, à Beuil, les 3 et 12 août, renforçant le potentiel des FFI du Haut-Var.
Le 5 juin à 20 heures, la BBC diffusa les messages d'exécution dans la région R2 du plan vert (sabotage des voies ferrées) et du plan rouge (rassemblement des résistants), ce dernier n'ayant pas été exécuté. La mission R202 consistant en la coupure de la voie ferrée Nice-Monaco fut réalisée avec l'aide de résistants de Menton. La mission R209 - coupure de la voie ferrée Sospel-Coni - fut exécutée par les résistants de Breil. En revanche, les missions R 202 (coupure de la voie ferrée Nice-Monaco) et R208 (coupure de la voie ferrée Nice-Sospel) ne le furent pas.
Cette alerte du 6 juin, si elle avait révélé une demi-réussite sur le plan des destructions ferroviaires, démontrant ainsi la possibilité de désorganiser les communications allemandes par des sabotages systématiques, s'était soldée par un échec presque complet sur le plan de la guérilla.
Les Alpes-Maritimes, 1939 - 1945, un département dans la tourmente, Editions Serre, 1989 (p.218-219).
Portraits de résistants et de lieux de Résistance haut ▲
La figure la plus emblématique de la Résistance intérieure est sans doute celle de Jean Moulin, préfet révoqué en novembre 1940, dont la famille est originaire de Saint-Andiol (Bouches-du-Rhône). Il vit lui-même dans ce village en 1940 et 1941, sous sa véritable identité. Il se déplace dans la région sous le nom de "Joseph Mercier", prend d'abord contact avec les mouvements de Résistance de la zone Sud et prépare son voyage à Londres. Il obtient à cet effet un "vrai-faux" passeport et réussit finalement à partir à la fin de l'année 1941. Après sa rencontre à Londres avec le général de Gaulle, il est parachuté dans les Alpilles le 2 janvier 1942 comme représentant de ce dernier. A Salon-de-Provence, un mémorial immortalise cet épisode.
Brochure du Murel, p. 14

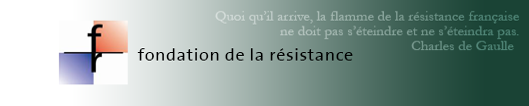
 Voir le bloc-notes
()
Voir le bloc-notes
()