La Libération
Nice est libéré le 28 août 1944 à la suite d'une insurrection armée décidée par la Résistance. Celle-ci démarre non seulement en réaction aux nombreuses exécutions de résistants mais aussi à la proclamation de l'état de siège et de la loi martiale engendrant notamment une grave pénurie alimentaire qui touche le département. Tandis que le préfet Ravard demande, le 17 août à la Feldkommandantur de déclarer Nice ville ouverte...
D'après Jean-Louis Panicacci
Le débarquement allié en Provence haut ▲
Le 15 août 1944, au cours de la nuit, des Dakota larguent les parachutistes de la 1st Air-Borne Task Force (AITF) au-dessus de la zone de Draguignan-Le Muy, tandis qu'une flottille d'embarcations d'assaut s'approche de la pointe de l'Esquillon à Théoule, avec les 67 hommes du Groupe naval d'assaut français, dont la mission consiste à interrompre les deux routes reliant Cannes à Fréjus et à St-Raphael, de façon à couvrir le flanc droit de l'opération "Dragoon". La section devant s'engager à l'intérieur des terres, forte de 42 hommes, débarque la première et entreprend la difficile ascension de la calanque en progressant vers la pointe de l'Esquillon, malgré les meurtrières mines et explosions.
En quelques minutes, le commando déplore 11 tués et 19 blessés graves. Pendant ce temps, le général Fretter-Pico, en inspection dans l'Estérel, échappe de peu aux patrouilles du 141e RCT (Regimental Combat Team). Quant au bataillon motorisé qu'il a envoyé débloquer le PC du 62e Corps d'armée à Draguignan, il est stoppé à 8 kilomètres de son objectif et doit se replier sur la région grassoise.
En mer, une manoeuvre de diversion est opérée dans la région cannoise par une flottille - commandée par Douglas Fairbanks junior - qui lâche des ballons et tire des obus de 102 mm sur Golfe Juan (4 tués, 3 blessés), Cannes (2 tués, 4 blessés), Antibes, La Napoule et Théoule, où il n'y a que des dégâts matériels.
Les autorités allemandes proclament l'état de siège : les Azuréens vivant au-dessous de la ligne Grasse-Vence-Contes-l'Escarène-Sospel n'ont plus le droit de sortir de leurs habitations jusqu'à nouvel ordre, hormis les membres de la Défense passive, les pompiers, les médecins, les gendarmes et les policiers.
Face à la pléthore de moyens des Alliés, les Allemands, dépassés, préparent leur repli vers l'Italie, la Gestapo et ses auxiliaires - miliciens et Groupes d'actions du PPF - en tête.
Un peu partout dans l'arrière-pays, c'est la mobilisation des FFI -comme à St-Etienne de Tinée à l'initiative du docteur Jouglard - et l'encerclement des garnisons allemandes de Puget-Théniers, Bancairon et St-Martin-Vésubie. Plan-du-Var est libéré et le pont Charles-Albert passe sous contrôle FFI.
A Peille, les résistants sortent au grand jour les armes cachées dans les caves et la population se joint à eux : six groupes de combat sont formés, des instructeurs initient les volontaires au maniement des armes étrangères.
Libération de la rive droite du Var : (...)
Les Alpes-Maritimes, 1939-1945, un département dans la tourmente, Editions Serre, 1989.
Les opérations insurrectionnelles haut ▲
-1) libération de la rive droite du Var
- 2) libération de l'arrière-pays
- 3) les combats de Levens
- soulèvement de Nice
- libération des Corniches
2) Le 16, au lever du jour, le corps-franc du capitaine François obtient la reddition des 27 hommes de la garnison de Puget-Théniers, qui sont ensuite amenés à pied jusqu'à Beuil. Le lendemain, après de longues négociations menées par une villageoise, la garnison de St-Martin-Vésubie se rend au groupe Morgan et ses 37 hommes sont internés dans les casernes de Lantosque.
Le commandant FFI Malherbe installe son PC à Plan-du-Var. Le 18, le PC départemental FFI quitte Valberg pour Puget-Théniers, où Sapin apprend que la garnison allemande de Bancairon n'accepte de se rendre qu'un officier "régulier" des troupes débarquées.
A partir du 20, des partisans italiens de la Stura se replient sur la Haute-Tinée, le groupe Spada par les cols de Pouriac et du Fer, le groupe Nuto par le col de la Lombarde, permettant de renforcer la défense de la vallée au moment où beaucoup de FFI sont rassemblés devant Levens. Les éléments de la 90e Panzergrenadier occupent les cols frontaliers, opèrent des incursions en territoire français, occupant la Bollène le 21, s'installant à l'Aution le 22, à Belvédère le 24, à St-Martin-Vésubie le 26, forçant le groupe Hochcorn (capitaine Imbert) à se replier de nuit, par le col du Fort, les sabots des mulets entourés de chiffons pour étouffer le bruit, jusqu'à Clans. Le 25 août, les 250 hommes de la brigade "Giustizia e Libertà" Carlo Rosselli - commandés par le capitaine Nuto Revelli - s'installent à Mollières avec leur officier de liaison britannique Flight. Ce dernier organise une rencontre à Peirablanca avec le docteur Jouglard et le colonel Marchesi, qui détermine le passage en France de cette unité le 27, les partisans arrivant le lendemain à Isola, bien accueillis par la population.
Dans la Roya, des avions alliés mitraillent un convoi allemand le 16 août au col de Brouis, puis lancent 70 bombes sur la gare de Breil et le quartier de la Giandola les 16 et 18 août ; l'unité SS ayant stationné sur le littoral se replie par la vallée, demeurant du 18 au 21 à Fontan et Saorge, où elle prend 3 gendarmes en otages ; les troupes de passage multiplient les réquisitions, voire les actes de pillage.
Dans la région de Peille, des combats opposent, du 16 au 21 août, 130 FFI - issus du maquis FTP-MOI d'Ongrand, des Milices patriotiques de Peille et de la brigade de gendarmerie de Sospel - aux Allemands en poste au col des Banquettes, au mont Agel et à La Turbie. Le 16, 5 volontaires désarment sans difficulté les 3 Polonais de garde au téléphérique du mont Agel et chargent leur matériel sur un camion avant d'accrocher une patrouille allemande ; la riposte vient du fort qui bombarde le village et ses alentours, forçant le commandant FFI à faire évacuer les civils. Des accrochages ont lieu au col St-Pancrace les 17 et 19 août, date à laquelle le village est à nouveau bombardé. Le 20, les Allemands attaquent en force, contraignant les FFI à abandonner le col des Banquettes et le col St-Pancrace, puis à évacuer le village, à l'exception de l'hospice. Les combattants sans uniforme se replient le 21 sur le col de Braus, après avoir perdu 3 tués et 11 blessés, dont 3 déserteurs polonais.
3) Levens est occupée à partir du 16 août par les 8e et 24e compagnies FTP. Dans le même temps, les FFI occupent St-Martin-du-Var et la Roquette-sur-Var, renforcés par le maquis Combat, le 18 août, en provenance d'Aspremont.
Le 19 août, les Allemands installent 50 hommes et 2 canons de 37 au pont de Saint-Blaise. (p.234)
Les Alpes-Maritimes, 1939 - 1945, un département dans la tourmente, Editions Serre, 1989.
(2) p. 234-235
Scènes de la libération haut ▲
Les combats de Levens (p.235-236) :
A partir du 16 août, la commune est occupée par les 8e et 24e compagnies FTP, renforcées par des éléments provenant des 38e, 40e et 42e compagnies ; les FFI occupent dans le même temps St-Martin-du-Var et la Roquette-sur-Var, renforcés par le maquis Combat, le 18 août, en provenance d'Aspremont où il a perdu son chef, le commandant Gerome, et a été bousculé par une forte colonne allemande.
Le 23 août, une forte colonne allemande s'approche de Levens, mais une sentinelle FTP parvient à donner l'alerte. Les commandants Las, Janso et Job disposent leurs hommes de part et d'autre des grands chaumes qui précèdent le village, mettant en batterie leurs 2 FM et leurs 2 mitraillettes lourdes. Durement étrillés, les Allemands abandonnent ce jour-là toute tentative de prendre Levens.
Le 25 août, Malherbe décide de contre-attaquer avec les compagnies Morgan, Pyra, Pierre, César, les 8e et 27e FTP, mais les Allemands, disposant d'armes lourdes, repoussent facilement les maquisards. Les FFI abandonnent Plan-du-Var et se replient sur le Chaudan.
Les premiers Américains étant parvenus à Gattières et à Gilette le lendemain, Malherbe franchit le pont Charles-Albert sous les tirs allemands, pour informer les libérateurs de la situation délicate des FFI et solliciter leur aide pour reprendre Levens. Une préparation d'artillerie est d'ailleurs effectuée sur le village de 10 à 22 heures. Le 27 août, Plan-du-Var et St-Martin-du-Var sont réoccupés par les FFI, les Américains acceptent de franchir le Var et, guidés par des officiers du maquis, reprennent Levens, capturant 87 Allemands.
Les Alpes-Maritimes 1939-1945, Un département dans la tourmente, Editions Serre, 1989 (p. 235-236)
Les Américains sur le front des Alpes haut ▲
Les nouveaux pouvoirs haut ▲
(CLL, CDL, CRL, Etats-Généraux, presse.)
Les Comités locaux de Libération (CLL)
Des CLL sont installés par les FFI à la place de l'administration municipale démissionnaire ou évincée. La composition des CLL est plus homogène dans les villages de l'arrière-pays, où le FN est souvent majoritaire (Beuil, Puget-Théniers...), plus équilibrée et pluraliste dans les villes de la bande littorale (Antibes et Cannes), où les deux principaux mouvements (FN et MUR) comptent autant de représentants et cohabitent avec des délégués des Partis communiste et socialiste, du mouvement prisonnier, des organisations de femmes (FF) et de jeunes (FUJP), voire de personnalités résistantes.
Le CLL est présent dans 128 communes sur 161. Sur les 1 314 membres de CLL, on compte 16,5 % de FN, 13 % de personnalités, 11,5 % de communistes, 8,5 % de Femmes de France et de FUJP, 7,5 % de MUR-MLN, 6,5 % de socialistes et de représentants de l'Union paysanne, 5,5 % de cégétistes, 4,5 % de militants de Combat, 3 % de radicaux et 0,5 % de membres de la Résistance chrétienne.
Les CLL procèdent aux premières mesures d'épuration (supervisant dans 49 communes un comité d'épuration) et à l'organisation du ravitaillement, avant d'être consultés par le préfet sur la constitution des municipalités provisoires.
Le Comité départemental de Libération (CDL)
C'est à l'initiative des MUR que naît le Comité Départemental de Libération (CDL), entre les mois de décembre 1943 et de février 1944, officiellement installé à Nice par Francis Leenhardt, délégué général adjoint pour la zone Sud du CFLN d'Alger. Cet organisme est, à ses débuts, plus proche de la constitution de l'assemblée consultative d'Alger que de celle du CNR de Jean Moulin : 2 MUR (Alex Roubert alias "Hyacinthe", Jacques Cotta), 1 socialiste (René Bermond), 1 communiste (Jean Orbello), 1 CGT confédéré (Flaminius Bianchi), 1 CFTC (André Pruvost), 1 démocrate-populaire (Marcel Mouterde), 1 catholique résistant (abbé Girault). Le Front national n'y est admis qu'en avril 1944 avec Roland Claudel, en même temps que la CGT s'y fait représenter par l'unitaire Charles Andrieu.
Le CDL s'est installé à la préfecture le 29 août 1944, jouant également le rôle de CLL pour le chef-lieu. Il comprend désormais 18 membres, est présidé par le FN Sénèque Brunet et est dominé par la nébuleuse du FN (FN, FF, FUJP, Comité national des médecins, Comité des intellectuels) associée au PCF et à la CGT.
Les Etats généraux de la Renaissance française
Abordée lors de l'assemblée générale des CLL le 26 novembre 1944, la préparation des Etats généraux, devant se tenir à Paris le 14 juillet 1945, est surtout le fait du FN, voire du PCF, alors que le MLN et la SFIO manifestent une grande prudence à son égard. La population maralpine ne montre qu'un intérêt relatif pour l'événement.
Légitimée par les élections municipales du printemps 1945, la Résistance a occupé des postes de responsabilité mais s'est avérée impuissante à obtenir une épuration approfondie, à se comporter de façon unitaire et à maintenir une presse rénovée.
Les Alpes-Maritimes de 1939 à 1945, Editions Serre, 1989.
La Résistance azuréenne, Editions Serre, 2003.
Les maquis noirs et les attentats visant les FFI haut ▲
L'épuration haut ▲
Les divers groupes de FFI procèdent à l'arrestation de plusieurs centaines de suspects - sans qu'elle soit toujours justifiée - au cours de la première semaine de la Libération, le total de 2 532 étant atteint à la fin du mois de septembre 1944.
L'absence de centralisation de la répression - les commissions d'épuration FFI et du CDL, la Sécurité Militaire et la 18e brigade mobile opérant en ordre dispersé - entraîne une pagaille certaine et, plus grave, des élargissements incontrôlés, des disparitions de dossiers ou d'individus.
Les internements ont lieu au siège des mouvements (hôtels de Grande-Bretagne au Cannet, Scribe à Nice, Savoy à Menton), dans des bâtiments réquisitionnés et dans les maisons d'arrêt de Grasse et Nice.
Des dizaines de femmes ayant pratiqué la "collaboration horizontale" avec des occupants se voient raser le crâne et sont exposées aux lazzis de la foule ; les fabricants de perruques sont en rupture de stock dès le 12 septembre.
D'autre part, des exécutions sommaires sont commises : le procureur Bousquet en dénombre déjà 21 lors de la séance du CDL tenue le 31 août et il y en aura 65 jusqu'au 23 septembre, date d'entrée en vigueur de la Cour de justice. Si certaines d'entre elles sont effectuées après comparution devant un tribunal militaire improvisé condamnant à mort des personnes convaincues de délation ou de collaboration militaire - comme c'est le cas à Gattières le 29 août ou à Nice les 29 et 31 août - la plupart sont commises par des éléments incontrôlés, souvent résistants de la 25e heure voulant accomplir une action d'éclat ou procéder à un règlement de compter personnel sous le couvert de la Résistance. Ces actions se localisent le plus souvent sur les collines niçoises.
Une bavure est commise à Antibes le 23 septembre : à la suite de la mort d'un jeune FTP - vraisemblablement tué par ses camarades lors de l'arrestation mouvementée de deux collaborateurs qui sont d'ailleurs abattus - le capitaine P. exige 50 otages auprès du président du CLL qui lui en livre 10 (5 Italiens membres du PFR, le chef local de la Milice, le secrétaire local du PPF, un employé municipal et deux femmes suspectes de délation), parmi les internés du fort Carré, qui sont fusillés dans les fossés de l'ouvrage. Cette bavure est dénoncée par plusieurs membres du CDL lors des séances des 25 et 27 septembre, notamment par l'abbé Daumas et Joseph Collignon.
La 1ère section de la Cour de justice de Nice tient sa première séance le 23 septembre 1944, épaulée par la 2e section le 25 janvier 1945 et par la Cour de justice de Grasse le 9 février. Ces tribunaux sont appelés à juger les affaires les plus graves (intelligence avec l'ennemi, port des armes contre la France et ses alliés, dénonciation, complicité d'assassinat) pouvant entraîner des condamnations à la peine capitale, aux travaux forcés ou à la réclusion criminelle.
D'autres tribunaux, les Chambres civiques, appelés à juger les personnes coupables d'appartenance à un mouvement antinational, fonctionnent à Nice (1ère Section depuis le 5 décembre 1944, 2e Section depuis le 25 janvier 1945) et à Grasse (depuis le 27 février), prononçant des peines d'indignité nationale : perte des droits civiques, exclusion des fonctions publiques et des fonctions libérales, impossibilité d'administrer une société.
Les Alpes-Maritimes, 1939-1945, Un département dans la tourmente, Editions Serre, 1989 (p.247-248).
L'armée nouvelle et les combats sur les Alpes haut ▲
La victoire haut ▲
A Nice, L'Espoir du 23 avril sort un numéro spécial sur la prise de Berlin, alors que l'Armée rouge n'a fait qu'y pénétrer ; l'organe de la SFIO publie, le 29, en une "l'Allemagne a-t-elle déjà capitulé sans conditions ?" ; les 2 et 3 mai, les quotidiens maralpins annoncent la mort d'Hitler et la chute de Berlin, préparant l'opinion publique à la cessation des hostilités.
Le 8 mai, à 15 heures 15, les sirènes mugissent et les cloches sonnent à toute volée dans les villes du littoral, tandis que deux canons du 1er RA - qui a combattu à Bir-Hakeim - tirent, depuis le jardin Albert 1er, les 101 coups de la victoire. A 17 heures, les organisations politiques et les mouvements de résistance descendent l'avenue de la Victoire et se rendent au monument aux morts, suivi par des détachements américains et français (tirailleurs du BM 5, fusiliers-marins du 1er RFM, légionnaires de la 13e demi-brigade).
Des défilés ont lieu à Cannes, Antibes et Menton. Des pigeons voyageurs, symboles de paix, sont ensuite lâchés dans le ciel de la Baie des Anges, précédant la diffusion des allocutions de De Gaulle, Truman, Staline, Churchill et les discours de Paul Escande, Sénèque Brunet, Virgile Barel et du colonel Pugh, chef de l'USRRA (US Riviera Rest Area).
Les quotidiens sortent des éditions spéciales en couleurs, reproduisant les drapeaux alliés, le V de la victoire et les portraits de dirigeants politiques (de Gaulle, Churchill, feu Roosevelt, Truman et Staline) ou militaires (Eisenhower, Clark, Patton, de Lattre, Leclerc, Koenig, Montgomery, Joukov, Koniev, Tito), avec des manchettes de type "l'Allemagne a signé son désastre" (Combat), "Gloire aux nations unies" (l'Aurore), "Quelle est grande la victoire !" (Le Patriote), "La guerre est finie en Europe" (l'Espoir).
Les Alpes-Maritimes de 1939 à 1945, un département dans la tourmente, Editions Serre, 1989 (p. 267 - 268).
Les élections municipales, cantonales et législatives de 1945 haut ▲
La reprise des compétitions électorales est amorcée dès janvier 1945 avec les débats du CDL relatifs à la nomination des conseillers généraux et à l'invalidation de plusieurs sortants, dont l'avocat Jean Médecin.
La préparation des élections municipales donne lieu à un débat nourri sur la question de la Liste Unique de la Résistance au 1er tour à laquelle sont favorables le FN, la CGT, le PCF, le MNPGD et hostiles le MLN, la SFIO, le MRP, le Parti radical et le mouvement Combat.
Une fois achevée la campagne municipale, les partis se préoccupent déjà de la préparation des élections cantonales. La campagne est marquée par deux événements retentissants : le rapprochement Virgile Barel-Jean Médecin à Nice et la scission du conseil municipal de Cannes. A l'issue du 2e tour, 7 communistes supplémentaires font leur entrée au Conseil général, en compagnie de 2 SFIO, 1 FN, 1 USR, 1 radical et 2 modérés : J. Médecin à Nice et M. Roustan à Antibes. L'Assemblée départementale est considérablement renouvelée (25 nouveaux sur 30) et enregistre un renversement spectaculaire de majorité (20 élus du PCF et de la SFIO). Le PCF sort ainsi grand vainqueur de cette consultation, réalisant des scores exceptionnels au 1er tour (58 % à Nice II, 59 % à Beausoleil) et plaçant l'une de ses deux figures de proue à la tête de l'assemblée départementale.
Un mois plus tard, les Azuréens sont appelés aux urnes pour désigner 5 députés devant les représenter à l'Assemblée constituante et répondre par "oui" ou "non" au référendum institutionnel. Le "oui" l'emporte aux deux questions : 98 % pour la suppression de la IIIe République et 59 % pour le projet proposé par le Gouvernement provisoire. Les Alpes-Maritimes se distinguent de la moyenne nationale par un vote plus massif en faveur du "oui" à la 1ère question (90 %) et, par opposition, plus forte à la 2e question (66 %), pour laquelle le PCF a appelé à voter "non".
Les Alpes-Maritimes, 1939-1945, Un département dans la tourmente, Editions Serre, 1989 (p. 273-277)

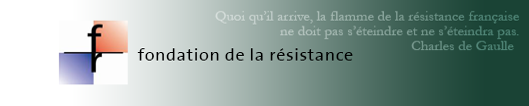
 Voir le bloc-notes
()
Voir le bloc-notes
()